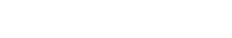Article – Ratios soignants à l’hôpital: bonne ou fausse idée? Les serpents de mer existent peut-être, en fin de compte…
Karin Masini, consultante du pôle Stratégie et Performance du CNEH et Brigitte de Lard-Huchet, directrice du centre de droit JuriSanté du CNEH
Article paru dans la revue Gestions hospitalières n° 644 – mars 2025
La loi n° 2025-74 du 29 janvier 2025 relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé a finalement vu le jour, et dans quel contexte ! Adoptée alors même que nous ne disposions pas à ce moment de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025 ! C’est dire si le serpent de mer a la peau dure. De nombreuses questions parlementaires y ont fait référence ces dernières années, en lien avec les problématiques de conditions de travail, d’attractivité et de pénurie des ressources paramédicales à l’hôpital[1]. Pour autant, le débat perdure. Alors que contient vraiment ce texte, et qu’en penser ?
L’idée
L’idée est simple, et se résume en trois points.
● En premier lieu, la loi pose un principe général de ratio soignants. Ainsi, en vue de garantir la qualité des soins et des conditions d’exercice, est défini pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires (art. L.6124-3 du Code de la santé publique – CSP).
Cette règle du ratio sera :
- posée par type d’activité de soins au sens de l’article R. 6122-25 CSP. Cela pose toutefois la question des activités qui ne génèrent pas d’hospitalisation (à temps complet ou en ambulatoire) ; par exemple pour la médecine nucléaire, ou l’assistance médicale à la procréation ;
- posée également par spécialité, ce qui sous-tend l’idée qu’en hospitalisation, les spécialités médicales ne justifient pas toutes le même ratio soignant et celle, paradoxalement, qu’on peut définir un ratio dans le cadre aussi large de la « spécialité », à l’inverse de l’évolution constituée par les surspécialisations reconnues pour définir les compétences médicales.
La loi précise que le ratio tient compte de la charge des soins liée à l’activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement. Qu’entendra-t-on par spécialisation ou taille ? Dimension hospitalo-universitaire ? Établissement en zone rurale ou urbaine ? Prise en compte du profil de la patientèle, âge, situation sociale ?
À noter : ce principe de ratio est posé au titre des conditions techniques de fonctionnement des activités de soins (art. L.6124-2 et s. CSP). À ce titre, il s’applique à tout titulaire d’autorisation, notamment tous les établissements de santé, quel que soit leur statut public ou privé, à but lucratif ou non lucratif.
● En deuxième lieu, la loi confie à la Haute Autorité de santé (HAS) la nouvelle mission d’établir, pour chaque spécialité et chaque type d’activité de soins hospitaliers et en tenant compte de la charge des soins associée, ce ratio minimal de soignants, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins (art. L.161-37-4° bis CSP). C’est sur la base de son avis que le pouvoir réglementaire établira, par décret, les ratios, pour une période maximale de cinq ans.
● Enfin, la loi tire deux conséquences pour les établissements assurant le service public hospitalier[2] :
- l’organisation des soins propre aux services de l’établissement au regard des ratios réglementaires est soumise pour approbation aux commissions médicales (CME) et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT). Les établissements devront ainsi formaliser les organisations de soins adoptées ou modifiées en conséquence des ratios ;
- un dispositif d’alerte est mis en place : lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de santé (DG ARS) territorialement compétent. Rappelons que si le ratio est une condition technique de fonctionnement de l’activité autorisée, son non-respect peut également engendrer la mise en oeuvre des procédures d’injonction, voire de suspension ou de retrait de l’autorisation. L’effectivité de ce risque reste à interroger…
Bonne idée ?
Les établissements de santé ont vu fleurir ces dernières années des conditions techniques et d’implantation pour leurs activités de soins autorisées, qu’elles soient inédites ou rénovées.
La question du ratio soignant est partie intégrante de ces conditions techniques de fonctionnement, comme en témoigne le positionnement des textes qui la fondent dans le Code de la santé publique. Elle est posée de longue date pour les activités de réanimation, élargie plus récemment à l’ensemble des soins critiques. Elle n’est donc ni foncièrement nouvelle ni particulièrement surprenante dans son concept.
Elle participe de l’idée que l’exercice d’une activité de soins implique, outre le respect de critères environnementaux, de locaux, d’équipements, d’organisation et de protocolisation, de volume d’activité, la conformité à des exigences en matière de ressources humaines. Or, jusqu’ici, les récents textes adoptés posaient pour l’essentiel des exigences de qualification des personnels (par exemple, les personnels paramédicaux en soins médicaux et de réadaptation gériatrique, doivent être formés à la prise en charge gériatrique – art. D.6124-177-13 CSP).
S’agissant des effectifs, l’exigence réglementaire était plutôt indigente et se limitait pour de nombreuses activités à l’énoncé d’un principe d’adaptation des effectifs « au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins ». Par exemple, pour les activités de médecine, « la continuité des soins […] est assurée au sein de l’unité d’hospitalisation à temps complet par au moins deux professionnels paramédicaux, dont au moins un infirmier […] » (art. D. 6124-218 CSP). Aucune prise en compte dans ce texte de la spécialité médicale pratiquée, du profil des patients, de la taille du service et de l’établissement.
En cela, le texte renvoyait à la responsabilité exclusive des établissements le soin de fixer eux-mêmes les ratios qu’ils estimaient adaptés à la nature de leurs activités. Ratios que peu d’établissements aujourd’hui ont formalisés, et encore moins parmi eux sont en mesure de tenir sur la durée. Une règle de… dérégulation en somme.
La philosophie du droit des autorisations est de pouvoir poser des normes qui garantissent la qualité et la sécurité des soins pour une activité. Elle permet de garantir au patient qu’il sera pris en charge et soigné conformément à des standards identiques et selon des modalités homogènes, qu’il se trouve à Dunkerque, Strasbourg ou Sarlat.
La mise en place de ces ratios ne fait donc que participer de l’idée globale selon laquelle les activités de soins autorisées doivent être régies par des règles communes, notamment s’agissant des ressources humaines alignées pour répondre aux exigences de qualité des soins. Une idée bonne en soi, voire une évidence de ce point de vue[3] !
La présente loi, quant à elle, n’est pas encore traduite dans les faits : elle précise en effet que l’essentiel de ses dispositions[4] entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
Mais finalement, l’idée est-elle si bonne que ça ?
Fausse bonne idée ?
Sur la forme, on peut se questionner sur notre fonctionnement parlementaire :
● qui préfère voter la loi qu’en contrôler l’exécution et, à ce titre, l’évaluation du fonctionnement des services dits « normés » et de la mise en œuvre des décrets 98-900 et 2005-840 ou plus récemment du décret 2022-694 (relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins critiques) aurait été instructive ;
● qui n’a pas joué son rôle de filtre lors du dépôt de la proposition : cette dernière est de nature à aggraver la charge publique sans prévoir la recette nécessaire – car les effets bénéfiques attendus sur l’absentéisme ne seront pas immédiats. De ce point de vue, la proposition n’était pas recevable.
Sur le fond, cette idée de ratio traduit une profonde méconnaissance des ressorts de l’absentéisme. Le rapporteur du texte se base sur les résultats des magnets hospitals nord-américains qui étaient plus performants (au sens global, qualité-sécurité des soins, satisfaction des patients et des professionnels, rentabilité économique) en ayant des ratios de soignants plus élevés que les autres. Mais si cette donnée est validée, elle repose sur huit critères qui n’ont pas retenu l’attention du législateur :
● une autonomie des soignants dans leur sphère de décision clinique ;
● un soutien fort de l’institution envers la formation des personnels ;
● un leadership infirmier de type transformationnel (stimulation du changement) ;
● un mode de management participatif favorable à l’autonomisation des soignants (ce qu’on nomme « empowerment ») ;
● un climat relationnel collégial entre les médecins et les soignants, les médecins exerçant à titre libéral ;
● une gestion des effectifs adéquate, adaptée à la charge de travail et aux besoins du patient (ratios élevés) ;
● une culture du soin centrée sur les besoins du patient et l’importance de la qualité (accroissement de la satisfaction au travail) ;
● des soignants experts dans leur art (et formateurs).
Et, de manière pratique, la performance attendue est un objectif à moyen-long terme et génère a minima des coûts de transformation pour les deux à trois futures lois de financement de la sécurité sociale et lois de finances (qui prend en charge la formation initiale).
Plutôt que de documenter le sujet, le Parlement a préféré céder à la facilité de l’histoire qu’on raconte : des directions – parfois à la limite d’être assimilées à celles de grands groupes internationaux – qui réduisent régulièrement les ratios soignants au nom de la performance médico-économique et refusent de remplacer les absences. En sauveur, le Parlement a voté cette loi.
De nombreux directeurs ont pu vivre une autre histoire, celle d’une équipe régulièrement au bord de la rupture, dont la qualité de vie au travail et l’engagement changèrent avec de nouvelles méthodes managériales. L’absence de conflits, l’ambiance générale basée sur un respect mutuel et la capacité à fédérer et faire vivre un collectif, à y intégrer de nouveaux arrivants, constituent les premiers ressorts de la qualité de vie.
Si la loi oblige à ce sujet les établissements à réfléchir à un projet de gouvernance et de management participatif, le Parlement a préféré légiférer de nouveau plutôt que vérifier la mise en oeuvre d’un texte qu’il avait voté en 2021.
L’imposition de ratios intervient par ailleurs dans un contexte assez défavorable de tensions sur les ressources humaines et de fermetures de lits associées (documentées largement par la Drees qui estime la baisse globale à 10,5 % en 10 ans sur la base SAE 2023). Les deux effets conjugués sont de nature à renforcer encore les inégalités territoriales et entre établissements.
Pour simplifier, plus la taille de l’établissement augmente, plus le ratio est favorable. En théorie, cela s’explique par la charge en soins d’un service universitaire ou d’un établissement de référence, supérieure à celle d’un établissement de proximité, du fait de la gradation des soins (les soins courants en établissement de proximité, spécialisés en établissement de référence et très spécialisés en établissement universitaire).
Mais pour préciser les points techniques, le ratio soignant ne se traduit pas seulement par le nombre de professionnels au lit du patient : au-delà de l’importance du collectif déjà évoqué, le support aux soins est fondamental et il est très variable d’un établissement à l’autre.
On pense par exemple à :
● l’informatisation et à l’ergonomie du dossier patient (certains établissements n’ont pas d’informatisation généralisée de leur dossier ou doivent composer avec plusieurs logiciels et des re-saisies) ;
● aux services supports à disposition du service de soins (livraisons dans le service, gestion des médicaments, des consommables, du linge, des repas, des déchets… : certaines équipes doivent dégager des personnels pour assurer la logistique ou les courses).
Enfin, chaque établissement adopte ses règles de gestion du temps de travail, dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel : globalement, on observe que des règles sont plus favorables dans les gros établissements et dans les métropoles, pour prendre en compte les temps de transport.
À charge pour la HAS de définir le ratio : est-ce par lit ouvert comme pour les soins critiques ? par lit occupé comme dans le cas de la périnatalité – occupé au cours des trois dernières années et lissé ou au jour le jour ? au regard de la charge en soins évaluée en temps réel ? Le sujet est complexe, et nul doute que la HAS aura à cœur de répondre précisément à la question avant 2027, en s’appuyant sur des comités d’experts.
Mais concrètement, comment seront articulées les responsabilités du chef d’établissement et celles de la gouvernance médicale ?
Le droit fixe bien l’obligation d’égal accès aux soins et la continuité de ces derniers. La mise en œuvre de la loi amènera donc à fermer des lits pour respecter les ratios, mais l’obligation d’accueillir les urgences n’a aucune raison de tomber.
Logiquement, les transferts de patients seront indispensables, et quand ils ne seront pas possibles faute de place, le patient restera aux urgences, sur un brancard, dans des conditions que nous dénonçons tous. L’orientation des patients incombera aux équipes médicales, avec l’aide des équipes soignantes. Quel sera le sens quotidien de leur travail ?
Une autre idée ?
Au lieu d’imposer des ratios sur la base des organisations actuelles, une nouvelle idée pourrait être de transformer les organisations existantes et en créer de nouvelles, centrées réellement sur les besoins des patients. En acceptant le principe de segmentation de la population sur des critères de besoins homogènes (pathologie, comorbidités, dépendance et précarité), on pourrait déterminer des modes et des niveaux de prise en charge différenciés, avec une intensité soignante plus ou moins élevée. Le premier champ de travail pour cette approche populationnelle pourrait être la personne âgée fragile, pour laquelle on construirait une organisation dédiée, intégrant la possibilité d’une plus forte densité de soins, là où elle fait cruellement défaut aujourd’hui.
Peut-être aussi qu’associer plus largement les acteurs de terrain et leur laisser une marge d’appréciation et de créativité montrerait que, comme dans les établissements où il l’impose depuis 2021, l’État promeut un management participatif ?
Notes
[1] Assemblée nationale, Question écrite sans réponse n° 99000, 20 septembre 2016, M. Guy Teissier. Question écrite sans réponse n° 43888, 1er févr. 2022, M. Yannick Favennec-Bécot.
[2] Essentiellement les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d’intérêt collectif (Espic).
[3] Sur cette base théorique, des dispositions relatives aux ratios de personnels étaient déjà présentes dans les décrets périnatalité, annoncés comme précurseurs d’une généralisation restée sans suite pendant 27 ans.
[4] Et la compétence de la HAS entre bizarrement en vigueur au plus tard le 31 décembre 2024 ?. Cf. article 1-III de la loi.