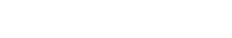Article – La clause de conscience dans le service public hospitalier, un équilibre délicat entre éthique, morale et droit du patient
Isabelle Génot-Pok et Aude Charbonnel, consultantes du centre de droit JuriSanté du CNEH
Article paru dans la revue Gestions hospitalières n° 643 – février 2025
En janvier 2025, la loi Veil relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) a fêté ses 50 ans. Une loi qui a pour la première fois posé le principe légal de la clause de conscience spécifique. Une loi qui a permis ainsi de ménager la liberté de conscience des professionnels tout en permettant de respecter le droit des patientes. À l’occasion de cet anniversaire, il est intéressant de revenir sur cette notion de clause de conscience qui est loin de se limiter aux actes pratiqués dans le cadre de l’IVG. Une clause parfois mal comprise dans son concept comme dans son application et dont les fondements sont susceptibles d’être remis en cause par une évolution ou une avancée sociale, parfois indifférente aux raisons originelles de sa création [1].
Définition, cadre légal et applications
La clause de conscience est la possibilité pour tout individu de refuser de réaliser ou de participer à un acte, une action, autorisé(e) par la loi mais contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles, religieuses, éthiques ou morales. Elle est liée à la notion de liberté de conscience inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [2] reprise dans le préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 [3]. Par ailleurs, la décision n°2001-446 DC du 27 juin 2001 du Conseil constitutionnel établit la liberté de conscience comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il s’agit donc d’une liberté fondamentale intrinsèquement attachée à la qualité d’individu et de citoyen(ne), partie intégrante du respect de la dignité.
Ainsi, la clause de conscience existe dans plusieurs domaines de la vie civile – journalisme, monde de l’entreprise, barreau – et repose sur des conditions définies par la voie législative, contractuelle ou jurisprudentielle.
Elle s’applique aussi dans le domaine de la santé ; son fondement et ses conditions reposent sur des textes législatifs ou réglementaires précis.
Elle permet à certains professionnels de santé de disposer de la possibilité de refuser la réalisation d’un acte de soin, d’un acte médical ou technique ou seulement d’y participer. Toutefois, les textes distinguent deux types de clause de conscience : la clause de conscience générale et la clause de conscience spécifique.
La clause de conscience générale
La clause de conscience générale a vocation à s’appliquer pour tout type d’acte [4], d’action, de réalisation qui pourrait heurter la conscience du professionnel au regard de ses convictions philosophiques, politiques, religieuses. C’est donc une protection permettant au professionnel de santé
qui en bénéficie d’exercer sa liberté afin de se mettre en retrait à l’égard d’un acte qui viendrait en contradiction de sa conscience sans risquer une sanction. Elle trouve son fondement dans la déontologie professionnelle [5]. Même si cette clause de conscience peut s’appliquer à n’importe quel acte de soin, elle a surtout vocation à s’appliquer aux actes médicaux non thérapeutiques, qui peuvent heurter les convictions personnelles et professionnelles. Cette dernière condition n’est cependant pas plus précisée par les textes.
La clause de conscience spécifique
La clause de conscience spécifique ne s’applique qu’à un acte particulier. Dans notre législation actuelle, il n’existe que trois situations où elle est prévue :
- l’interruption volontaire de grossesse : article L.2212-8 [6] du Code de la santé publique (CSP) ;
- la stérilisation à visée contraceptive : article L.2123-1 [7] du CSP ;
- la recherche sur les embryons : article L.2151-7-1 [8] du CSP.
Particularités
Il existe donc deux clauses de conscience, est-ce à dire qu’il y a une double clause ? Il n’en est rien. Ces deux clauses ne sont pas identiques car elles ne recouvrent pas les mêmes champs et n’ont pas les mêmes effets. On touche ici aux limites de leur application.
D’une part, ces clauses de conscience bénéficient à des professionnels différents mais définis par les textes (cf. infra). D’autre part, la clause spécifique repose sur un principe absolu (par exemple, les praticiens ne sont jamais tenus de pratiquer une IVG), alors que la clause générale prévoit une exception à son application, en ce qu’elle ne peut pas être invoquée en cas d’urgence ou lorsque le professionnel manquerait à ses devoirs d’humanité [9]. Il y a ici une logique juridique. Les actes visés par une clause de conscience spécifique ne correspondent pas en soi à des situations d’urgence dans lesquelles pourrait se retrouver l’usager. D’où sa portée absolue. À la différence de la clause de conscience générale, qui dès lors qu’elle peut s’appliquer à tout autre acte dans toute autre situation – hors champ d’une clause spécifique –, sa mise en œuvre est de fait limitée par l’urgence de la prise en charge afin de sauvegarder la santé du patient [10].
Cependant, dans chacun des cas, quelle que soit la clause utilisée, le professionnel qui met en avant sa clause de conscience a deux obligations :
- informer sans délai (à savoir dès la première consultation) le ou la patiente de son refus de pratiquer ou de participer à un acte [11], en communiquant clairement sur ses raisons;
- communiquer immédiatement au patient ou à la patiente (quand bien même cela heurterait aussi sa conscience) le nom d’un professionnel susceptible d’assurer sa prise en charge. Ici se jouent les principes de non-discrimination, du droit à l’accès aux soins et celui de continuité des soins [12] (cf. infra).
Enfin, il est nécessaire de rappeler que ces deux clauses n’ont pas la même valeur juridique :
- la clause spécifique a été consacrée par la loi, ce qui lui donne une force particulière, notamment quant à la protection du professionnel qui refuse absolument d’accomplir un acte ;
- la clause générale n’est porteuse que d’une valeur réglementaire, donc juridiquement inférieure, et contient des limites à sa mise en œuvre.
L’absence de clause spécifique pour certains actes aurait pour conséquence d’abaisser la valeur juridique de la protection des personnels soignants. De plus, un dispositif réglementaire peut être plus facilement supprimé, la voie législative n’étant pas nécessaire, ce qui le rend plus vulnérable.
Les professionnels concernés
Bien qu’il existe une clause de conscience générale, cela n’implique pas que tous les professionnels de santé en bénéficient. Un texte réglementaire doit la prévoir pour en autoriser l’application et désigner les professionnels concernés. Dans le domaine de la santé, cette clause n’est inscrite que dans certains codes de déontologie professionnelle : médecins, sages-femmes, infirmiers, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues. Seuls ces professionnels disposent de cette liberté. Ce qui exclut les autres professionnels de santé tels que les pharmaciens, les aides-soignants, les orthophonistes, les diététiciens.
De même, la clause de conscience spécifique ne bénéficie qu’aux professionnels nommément cités dans le texte qui la prévoit mais indépendamment de la déontologie professionnelle. Ainsi, concernant l’IVG, il s’agit des médecins, sages-femmes, infirmiers et auxiliaires médicaux. Concernant la stérilisation à visée contraceptive, seuls les médecins sont cités. Enfin, concernant la recherche sur l’embryon, plusieurs professions en disposent : tout chercheur, ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, médecin ou auxiliaire médical.
Il s’agit ici d’une liste « fermée » à laquelle il n’est pas possible d’adjoindre d’autres professionnels. C’est sans doute une des raisons pour laquelle supprimer une clause de conscience spécifique pour ne garder que la générale ne protégerait plus les professionnels qui ne bénéficient pas d’une clause générale tels que les auxiliaires médicaux (par exemple les aides-soignants).
Pharmaciens, les « oubliés » de la clause de conscience ?
Aucune des catégories citées plus haut n’intègre la profession de pharmacien malgré l’existence de leur code de déontologie, et leur qualité de professionnels de santé. On notera cependant que lors de la refonte de leur code en 2015-2016, le bureau du Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait proposé la rédaction d’une clause générale, laquelle avait soulevé une vive polémique. Finalement, cette proposition a été retirée de la version définitive dudit Code de déontologie. Revenu à la charge, à l’occasion du projet de loi de juin 2024 relatif à l’accompagnement et à l’aide à mourir [13], le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires et le Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé s’indignent de l’absence de reconnaissance à leur profit d’une clause de conscience sinon générale du moins spécifique au regard de leur participation à la dispensation des médicaments dans le cadre de la fin de vie. Cet acte pharmaceutique allant, selon leur analyse, au-delà de la simple prestation de service [14].
Pour l’heure, d’un point de vue juridique, les pharmaciens ne peuvent pas opposer de clause de conscience ; ils doivent appliquer les prescriptions répondant aux conditions légales et organiser la dispensation des médicaments.
Quoi qu’il en soit, cette liberté individuelle reconnue à certains professionnels ne peut et ne doit contrevenir systématiquement au droit de tout usager d’être pris en charge et d’obtenir les soins que requiert son état de santé. Il s’agira alors pour les établissements publics de gérer cet équilibre dans le cadre de leurs organisations internes, voire externes, au sein du groupement hospitalier de territoire (GHT) afin que l’usager ne subisse aucune conséquence dommageable.
La nécessaire responsabilité collective face aux dilemmes personnels
L’exercice de la clause de conscience nécessite une articulation entre liberté individuelle et responsabilité collective. Car si la clause de conscience constitue un droit pour les professionnels, elle ne peut s’exercer au détriment des droits du patient. Une approche équilibrée, aménageant respect des convictions individuelles et intérêt collectif, est donc indispensable pour préserver les droits de tous.
Clause de conscience et droits du patient
Plusieurs principes fondamentaux guident les droits du patient et peuvent apparaître en contradiction avec la clause de conscience, notamment :
- l’accès aux soins : les professionnels et les établissements de santé contribuent à garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurent la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible (art. L.1110-1 du CSP) ;
- le principe de non-discrimination : aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins (art. L.1110-3 du CSP). Un professionnel de santé ne peut refuser de prendre en charge une personne pour l’un des motifs énoncés à l’article 225-1 du Code pénal (par exemple l’article R.4127-7 du CSP).
Dès lors, lorsque la clause de conscience est invoquée, elle ne doit jamais conduire à une rupture d’accès aux soins et être vécue comme une discrimination. C’est la raison pour laquelle le professionnel de santé doit toujours informer le ou la patiente, notamment des raisons de son refus, et l’orienter vers une alternative conforme à ses besoins.
Droit versus morale : la clause de conscience en balance
Le droit est un ensemble de règles établies par l’État et applicables à tous, tandis que la morale repose sur des principes subjectifs qui peuvent varier selon les individus et les sociétés. La clause de conscience peut ainsi générer une tension entre ces deux ordres.
À titre d’illustration, un médecin peut refuser de pratiquer une IVG en vertu de sa clause de conscience, bien que l’IVG soit un droit pour les patientes. Ici, le droit positif entre en conflit avec une considération morale individuelle.
Pour autant, on ne peut appréhender la clause de conscience comme une opposition frontale au droit des personnes ; il s’agit plutôt d’une manière pour le droit d’intégrer la « palette » des convictions morales. Ce mécanisme d’articulation permet ainsi au droit de prendre en compte les exigences de la morale individuelle tout en imposant des limites pour éviter qu’elle ne devienne un instrument de discrimination ou de refus d’un droit fondamental.
La clause de conscience spécifique dans un contexte de pénurie de professionnels de santé
La clause de conscience spécifique protège une liberté sans en entraver une autre. Mais cela ne peut fonctionner que dans l’hypothèse où il y a suffisamment de professionnels de santé qui ne mettent pas en œuvre leur clause de conscience.
Leur disponibilité peut en effet influencer l’application de cette clause, ce qui soulève des enjeux d’accès aux soins et d’égalité entre les patients selon leur lieu de résidence. C’est une réelle difficulté dans les déserts médicaux si plusieurs professionnels invoquent la clause de conscience, en particulier dans les domaines de l’IVG et de la stérilisation. Dans certaines régions où le nombre de professionnels de santé est limité, l’invocation systématique de la clause de conscience peut devenir un problème collectif et compliquer l’accès à des actes de soins ou médicaux. Quid de la responsabilité des établissements publics de santé, des agences régionales de santé, de l’État ?
Dès lors, le seul moyen de garantir l’équilibre entre convictions personnelles et devoirs professionnels est de s’assurer d’un nombre suffisant de professionnels dans le cadre d’un maillage territorial adapté. Cela ne serait donc finalement qu’une question de ratios ? Un rapprochement, maladroit peut-être mais pas inintéressant, avec la récente loi instaurant un nombre minimum de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins [15].
L’absence de clause de conscience collective
La clause de conscience ne peut être appliquée de manière collective. Le Conseil constitutionnel avait été saisi à l’occasion de l’adoption de la loi relative à l’IVG et la contraception en 2001 [16]. Il était notamment soulevé une méconnaissance de la liberté de conscience des chefs de service public de santé. Ce reproche était basé sur l’abrogation des dispositions antérieures prévoyant qu’en cas de refus d’un chef de service, les IVG seraient pratiquées dans une unité spécialisée (art. L.2212- 8 du CSP). Le grief a été écarté par les Sages, considérant qu’il appartient au chef de service « philosophiquement hostile à l’IVG de désigner, dans le cadre de la direction de son service, tel ou tel autre médecin de celui-ci. La seule circonstance que des IVG se déroulent dans son service ne peut être assimilée à une atteinte à sa liberté de conscience. Cette liberté, qui constitue indiscutablement un principe fondamental reconnu par les lois de la République, est aussi une notion purement personnelle ».
Conclusion
Et demain, à la faveur d’une évolution législative tant sur la fin de vie que sur le suicide assisté, une nouvelle clause de conscience spécifique sera-t-elle nécessaire ? Dès 2022, le Comité consultatif national d’éthique affirmait que « toute évolution juridique dans le sens d’une dépénalisation de l’assistance au suicide devrait être accompagnée de l’institution d’une clause de conscience, accompagnée d›une obligation de référer le patient à un praticien susceptible de réaliser l’intervention [17] ». Suggestion reprise dans le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie débattu brièvement à l’Assemblée nationale au printemps 2024 avec la création d’un article dans le Code de la santé publique consacré à la clause de conscience. Mais l’instauration d’une nouvelle clause spécifique nous questionne : la clause de conscience générale ne devrait-elle pas suffire aux situations de fin de vie car il n’y a pas a priori de contexte d’urgence. Serait-elle alors socialement indispensable pour faire accepter une réforme à défaut d’être juridiquement nécessaire ? Pourquoi ajouter du texte au texte ? N’existe-t-il pas un risque de dénaturer la clause de conscience générale en multipliant les clauses spécifiques ? Et où poser la limite dans une société dont les individus semblent mettre de plus en plus en avant leurs propres convictions, au-delà de leur profession et de leur engagement dans le service public ? Quid demain du professionnel qui refuserait de pratiquer une transfusion sanguine, d’apporter tel repas au patient, de pratiquer une amputation ? Ne risque-t-on pas de vider de son sens une partie du métier de soignant à l’hôpital public ? Mais sur ces sujets-là, est-ce que la clause de conscience générale ne se heurte pas au devoir d’obéissance hiérarchique et à la responsabilité du professionnel dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées ?
Face aux tensions entre droits individuels et responsabilités collectives, il est nécessaire de maintenir un équilibre au service du maintien de cet édifice démocratique. Tout est affaire de proportion. Selon Aristote, la proportion est la traduction du juste, dès lors que « le juste est un milieu entre des extrêmes qui, autrement, ne seraient plus en proportion [18] ».
Notes
[1] Comme en témoignent les volontés de suppression de la clause de conscience. Par exemple : la proposition de loi visant à supprimer la clause de conscience en matière d’IVG en 2018 et le rapport d’information présenté à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2020.
[2] Article 10 de la DUDH : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public. »
[3] Préambule de la Constitution : « Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »
[4] Par exemple en matière de procréation médicalement assistée, don/prélèvements d’organes, greffes d’organes… ou dans le cadre de la fin de vie, telle que la sédation profonde.
[5] Exemples : articles R. 4127-47, R. 4127-328 et R. 4312-12 du Code de la santé publique.
[6] « Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse […]. Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse » (issue de la loi Veil, 17 janvier 1975).
[7] « […] Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive […] » (introduite dans la loi 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception).
[8] « Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L.2151-5 » (issue de la loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique).
[9] Seules certaines professions de santé ayant un code de déontologie disposent d’une clause de conscience générale : médecins (art. R.4127-47 du CSP), sages-femmes (art. R.4127-328 du CSP), infirmiers (art. R. 4312-12 du CSP), chirurgien-dentiste (art. R. 4127-232 du CSP), masseur-Kinésithérapeute (art. R.4321-92 du CSP), pédicures-podologues (art. R. 4322-54 du CSP).
[10] Le professionnel de santé pourra être poursuivi, pénalement, pour non-assistance à personne en péril (art. 223-6 du Code pénal).
[11] Articles L.1111-2 et R.4127-35 du CSP relatifs à l’information du patient.
[12] Article L. 6112-1 du CSP : « Le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l’article L. 6112-2. »
[13] Le débat reste intéressant voire essentiel pour les pharmaciens, bien que l’examen de la loi demeure en suspens depuis juillet 2024, alors que sa prochaine configuration pourrait relativiser les enjeux.
[14] Dépêche APM du 17 mai 2024 : « Le Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé (Synprefh) demande une clause de conscience pour les pharmaciens hospitaliers dans le cadre de la mise en oeuvre du droit à mourir, […] notamment dans le cadre de la réalisation des préparations magistrales létales qui sera exclusivement réalisée par les PUI […] quant à la délivrance de la préparation, elle sera effectuée par le pharmacien d’officine ou par la PUI elle-même si le patient est hospitalisé dans l’établissement dont elle relève. […] Le sort réservé aux pharmaciens hospitaliers suscite notre incompréhension; de plus, il nous paraît devoir constituer une discrimination par rapport aux autres professionnels de santé qui voient leur liberté de conscience ménagée par le texte» – www.apmnews.com
[15] Loi n° 2025-74 du 29 janvier 2025 relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé.
[16] Conseil constitutionnel, décision n°2001-446 DC du 27 juin 2001.
[17] CCNE, « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité », avis 139, 2022.
[18] Aristote, Éthique de Nicomaque, Flammarion, 1992, V, chap. 3, p. 142-143.