Article – Laisser mourir ou entrer dans l’obstination déraisonnable ? Les éternels questionnements du médecin sur le respect de la volonté du patient
Aude Charbonnel, consultante au centre de droit JuriSanté du CNEH
Article paru dans la revue Gestions hospitalières, n°621 – décembre 2022
L’année 2022 a relancé le débat sur le respect du consentement aux soins et l’application de l’article L.1111-4 du Code de la santé publique (CSP) : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » Alors que le contentieux relatif aux refus de transfusion sanguine pour motif religieux avait fortement ralenti, une « affaire » a récemment retenu toute l’attention. Par ailleurs et pour la première fois, c’est la portée des directives anticipées qui a été débattue devant le Conseil constitutionnel. Les médecins doivent-ils sauver un patient au mépris de ses convictions religieuses et de son refus de soins ? Et ces mêmes médecins peuvent-ils aller contre l’exigence d’un patient de vivre telle qu’inscrite dans ses directives anticipées ?
Respecter un refus de soins ou sauver le patient, le dilemme des médecins peut-il se résoudre par la force ?
Depuis des décennies, le juge a eu à se positionner sur cette question, soit à l’occasion d’un référé afin qu’il enjoigne à l’hôpital de ne pas procéder à une transfusion sanguine, soit à l’occasion d’une demande de réparation du préjudice moral suite à une transfusion sanguine réalisée contre la volonté du patient. La récente affaire jugée devant la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux le 20 octobre 2022 [1], intéressante et complexe, nourrit ce second contentieux.
La reprise des faits dans les détails est nécessaire avant tout commentaire. En l’espèce, une patiente admise dans un service de chirurgie digestive pour une ablation de la vésicule biliaire avait informé l’équipe médicale de son refus de recevoir des transfusions sanguines. À noter qu’en parallèle, les médecins avaient connaissance d’un document intitulé « Instructions médicales circonstanciées » dans lequel la patiente demandait, en sa qualité de témoin de Jéhovah, qu’on ne lui administre pas de transfusions de sang et qu’elle souhaitait bénéficier pleinement des techniques alternatives à la transfusion, dont le cell saver [2]. Lors de l’intervention chirurgicale, une perforation accidentelle d’une artère iliaque a causé une hémorragie qui n’a pas pu être compensée par le mécanisme d’autotransfusion mis en place conformément à la volonté de la patiente. Le pronostic vital étant engagé, des transfusions ont été réalisées. Puis, malgré le refus réitéré de la patiente, une nouvelle transfusion sanguine a été réalisée sur la décision collégiale de deux médecins, à l’insu de l’intéressée qui a été endormie et ne l’a appris qu’un an plus tard, lorsque son dossier médical lui a été communiqué à sa demande. La patiente a alors saisi la justice d’une demande de condamnation de l’hôpital à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral, en invoquant le caractère fautif des transfusions réalisées contre sa volonté, ainsi qu’un manquement au devoir d’information, tant sur le risque d’hémorragie lors de l’intervention que sur l’existence des deuxième et troisième transfusions. La juridiction d’appel va distinguer les transfusions successivement réalisées et affirmer que les premières transfusions sanguines ne peuvent être regardées comme fautives, la technique alternative du cell saver ne suffisant pas à assurer la survie de la patiente. En revanche, concernant la dernière transfusion, la CAA souligne qu’il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’intervention chirurgicale, les médecins ont insisté à plusieurs reprises pour tenter de convaincre la patiente, alors parfaitement consciente, de la nécessité d’une nouvelle transfusion en raison du risque vital encouru du fait de l’anémie sévère qu’elle présentait. La patiente a réitéré à plusieurs reprises son refus de ce traitement malgré les explications des médecins, l’échec du traitement alternatif et la dégradation de son état. La CAA retient qu’au regard de cette réitération telle que prévue par les dispositions de l’article L.1111-4 du CSP relatives au respect de la volonté du patient, le fait d’avoir réalisé une transfusion contre son gré, de surcroît en procédant préalablement à une sédation pour l’empêcher de s’y opposer, constitue un manquement à ces dispositions. Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin de rechercher si cette intervention était justifiée par une urgence vitale, cette troisième transfusion est de nature à engager la responsabilité de l’hôpital. Dès lors, la CAA conclut que les conditions de réalisation de la transfusion ont été à l’origine d’une souffrance morale et de troubles dans les conditions d’existence de la patiente et qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Est-il juridiquement (et éthiquement !) acceptable que, d’une part, les médecins réalisent une transfusion sanguine en procédant préalablement à une sédation pour empêcher la patiente de s’y opposer, malgré ses refus réitérés, et d’autre part que la patiente l’apprenne en consultant son dossier médical un an après la réalisation de l’acte ? Répondre par l’affirmative reviendrait à donner un « blanc-seing » aux médecins et viderait de toute sa substance la notion de consentement et de refus de soins posée par la loi.
L’analyse du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) dans son avis de 2005 sur le refus de traitement et l’autonomie de la personne [3] est éclairante : « En dehors d’un contexte d’urgence, le respect d’un refus de transfusion peut être accepté, quelles qu’en soient les conséquences (le transfert dans un autre établissement de soins peut être légitimement proposé). En effet, le dilemme ne se résout pas par la force. Ce n’est pas en forçant un témoin de Jéhovah à une transfusion que l’on résout la difficulté ; c’est en écoutant sa volonté, ses arguments, après qu’il a été informé le plus clairement et le plus respectueusement possible des risques majeurs que comporte sa position, dans des conditions d’environnement satisfaisant (dialogue singulier, absence de chantage, secret de la décision finale). Certes, ce refus est bien souvent le résultat d’une pression communautaire. Cette dépendance ne doit cependant pas faire perdre de vue l’intérêt de la personne qui, avant d’être le membre d’une communauté, est un être dont il faut préjuger l’autonomie et en tout cas la susciter ou la faire naître. Ne lui appartient-il pas de se soustraire in fine au dogme de son groupe et d’accepter la transfusion en assumant le risque de sa propre excommunication ? Certes, ce choix s’inscrit dans une “alternative déséquilibrée” : il doit s’opérer non pas entre un bien et un mal mais entre deux maux. Le sujet se voit contraint de sacrifier une des deux valeurs auxquelles il est le plus fortement attaché (sa vie ou son appartenance à sa communauté spirituelle). Mais pour être contraint, il n’en demeure pas moins un choix effectif comme l’atteste le cas d’adeptes qui décident d’accepter la transfusion, assumant du même coup leur exclusion du groupe. »
Il convient d’être prudent quant à la portée de cet arrêt de la CAA de Bordeaux ; une analyse du Conseil d’État serait intéressante. Soulignons d’une part que, de façon constante, la haute juridiction refuse toute position qui ferait primer par principe et en toute hypothèse, l’obligation pour le médecin de sauvegarder la vie sur la volonté du patient. Ainsi, les juges ont censuré en 2001 une décision d’une CAA car elle avait « entendu faire prévaloir de façon générale l’obligation pour le médecin de sauver la vie sur celle de respecter la volonté du malade ; que, ce faisant, elle a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt [4] ». D’autre part, évoquons une autre affaire jugée en 2022 dans laquelle le Conseil d’État a une nouvelle fois confirmé sa jurisprudence constante [5]. En l’espèce, et contrairement à la situation évoquée précédemment, la volonté du patient a été prise en compte puisqu’il y a eu restriction des transfusions au strict minimum (le respect des recommandations officielles aurait en effet conduit à des transfusions plus abondantes). En l’espèce, le patient était porteur, lors d’un grave accident sur la voie publique, d’un document dans lequel il indiquait, d’une part, refuser toute transfusion sanguine, « même si le personnel soignant estime qu’une telle transfusion s’impose pour me sauver la vie » et, d’autre part, il désignait son frère comme personne de confiance. Ce dernier a rappelé à l’équipe médicale, à plusieurs reprises pendant l’hospitalisation, que le patient était témoin de Jéhovah et ne souhaitait en aucune circonstance recevoir de transfusion sanguine. Toutefois, le patient présentant un état de choc hémorragique et une grande instabilité hémodynamique, il a été transfusé à plusieurs reprises. Le chef du service d’anesthésiologie de l’hôpital concerné a indiqué que pour tenir compte des instructions médicales écrites du patient, les transfusions faites ne l’ont été que dans la mesure strictement nécessaire au bon déroulement des actes permettant sa survie, alors que la stratégie transfusionnelle normalement appliquée à des patients dans un état de santé similaire est « libérale » et non « restrictive » et aurait abouti, en conséquence, à des transfusions d’un volume de sang plus élevé. Le Conseil d’État rappelle alors que le droit pour le patient majeur de donner son consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté fondamentale. En ne s’écartant des instructions médicales écrites dont le patient était porteur lors de son accident que par des actes indispensables à sa survie et proportionnés à son état, alors qu’il était hors d’état d’exprimer sa volonté, les médecins de l’hôpital n’ont pas porté atteinte à ce droit, non plus qu’aux autres libertés fondamentales garanties par les stipulations internationales, d’atteinte manifestement illégale. Passer outre les convictions religieuses du patient majeur est possible mais à ces seules conditions strictes.
Respecter la volonté de maintien en vie du patient conformément à ses directives anticipées ou l’interdiction de l’obstination déraisonnable, la décision finale doit-elle rester médicale ?
Alors que le débat sur la fin de vie reprend en France avec le lancement de la convention citoyenne [6], le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la possibilité pour les médecins de déroger aux directives anticipées d’un patient. En l’espèce, un patient a été victime en mai 2022 d’un polytraumatisme grave compliqué par un arrêt cardio-respiratoire après son écrasement par un véhicule utilitaire, ayant causé une absence d’oxygénation du cerveau durant plusieurs minutes. Admis dans un service de réanimation et placé dans le coma, l’état du patient a été considéré comme insusceptible d’amélioration. L’équipe médicale a estimé que la poursuite des thérapeutiques invasives constituerait une obstination déraisonnable. Elle a donc engagé la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2 du CSP, conduisant à la décision de procéder à l’arrêt des soins et des traitements. Cependant, l’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du 8 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en raison de l’existence d’une lettre manuscrite datée de 2020, adressée par le patient à son médecin traitant, qui n’avait pas été portée auparavant à la connaissance des équipes et dont la validité n’est pas critiquée. Ce courrier fait connaître les « directives anticipées dans le contexte médical » du patient, notamment son souhait, dans l’hypothèse où il ne serait plus en mesure de s’exprimer, d’être maintenu en vie, même artificiellement, en cas de coma prolongé jugé irréversible. La procédure collégiale a ensuite été reprise et, après plusieurs réunions, nouveaux examens et consultations extérieures, le maintien des actes et traitements est apparu à l’équipe médicale inutile et même disproportionné et comme n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie sans aucune perspective raisonnable d’amélioration. Dès lors, une nouvelle décision d’arrêt des soins, écartant les directives anticipées du patient comme manifestement inappropriées ou non conformes à sa situation médicale, a été actée par le chef du service de réanimation et portée à la connaissance des proches du patient qui s’y sont opposés. Les Sages ont finalement été saisis d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l’article L. 1111-11 du CSP par le Conseil d’État [7].
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 novembre 2022 [8], pose quatre affirmations :
- il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles un médecin peut écarter les directives anticipées d’un patient en fin de vie hors d’état d’exprimer sa volonté dès lors que ces conditions ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif poursuivi ;
- les dispositions contestées ne permettant au médecin d’écarter les directives anticipées que si elles sont « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » du patient ne sont ni imprécises ni ambiguës ;
- la décision du médecin ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer. Elle est inscrite au dossier médical et portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches ;
- la décision du médecin est soumise, le cas échéant, au contrôle du juge.
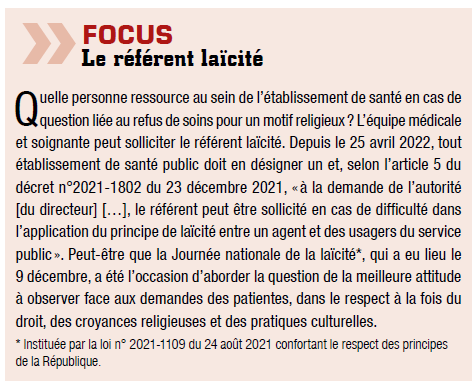
En conclusion, le Conseil constitutionnel retient que le législateur n’a méconnu ni le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni la liberté personnelle. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent ni la liberté de conscience, ni le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
En tout état de cause, les Sages ne se prononcent pas sur la situation spécifique du patient mais bien sur le cadre juridique des directives anticipées qui ne sera donc pas modifié… jusqu’à la prochaine grande réforme sociétale sur la fin de vie ? [9]
Conclusion
Que retenir de ces « affaires » ? La grande différence dans les situations évoquées est l’état de conscience du patient. Lorsque le patient n’est plus en capacité de s’exprimer, on mesure la difficulté pour les médecins, même en présence de directives anticipées et d’une personne de confiance, d’arbitrer car le doute persiste sur la volonté du patient à l’instant T. On ne doit pas nuancer l’intérêt de ces deux outils juridiques mais accepter que la décision médicale prime lorsque les conditions ne sont pas réunies pour les appliquer. Enfin, le conflit de loyauté dans lequel se retrouvent les familles et les proches vis-à-vis du patient doit être entendu et un accompagnement de qualité doit toujours être mis en place.
[1] CAA de Bordeaux du 20 octobre 2022, n° 20BX03081.
[2]Technique qui permet de récupérer le sang du patient durant l’intervention chirurgicale et à lui transfuser après lavage et filtration pour ne garder que les globules rouges.
[3] Comité consultatif national d’éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, Avis n°87, Refus de traitement et autonomie de la personne, 14 avril 2005.
[4] CE, 26 octobre 2001, n° 198546.
[5] CE, juge des référés, 20 mai 2022, n°463713.
[6] Le 13 septembre 2022, le président de la République a annoncé le lancement d’une convention citoyenne sur la fin de vie dont le pilotage a été confié au Conseil économique, social et environnemental
www.lecese.fr/conventioncitoyenne-sur-la-fin-de-vie.
[7] CE, 19 août 2022, n° 466082.
[8] Conseil constitutionnel, décision n°2022-1022 QPC du 10 novembre 2022.
[9] Dans sa décision du 22 novembre 2022 (n° 466082), le Conseil d’État a pris acte de la position du Conseil constitutionnel et rejeté les demandes de la famille du patient. Puis la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de ne pas indiquer au gouvernement français une mesure provisoire demandant de suspendre une décision de justice autorisant l’arrêt des soins de maintien en vie du patient (CEDH, 1er décembre 2022, n° 55026/22). Ces mesures ne préjugent toutefois pas pour autant des décisions ultérieures de la Cour sur la recevabilité ou sur le fond de l’affaire.


